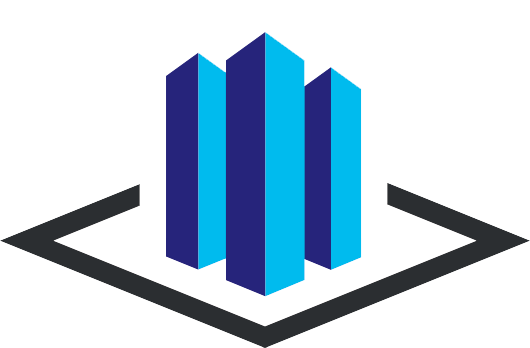Acheter un bien immobilier avec son concubin peut paraître très banal. Mais c’est oublier que ni le droit civil ni le droit fiscal ne reconnaissent le concubin comme héritier. Sur le plan civil, cela signifie que le survivant n’héritera de la quote-part du bien acquise par son concubin prédécédé qu’à la condition expresse que ce dernier ait fait un testament
Lire l'article
Retour à l’ancien barème de l’ISF : une taxe exceptionnelle en 2012
Pour des raisons juridiques, le barème de l’ISP, ses modalités de déclaration et de paiement ne devraient pas être modifiées cette année. Pour respecter la promesse de campagne de François Hollande, Bercy planche en revanche sur la création d’une contribution exceptionnelle. C’était un engagement de campagne du nouveau président François Hollande : redonner à l’ISF un rendement pérenne. En clair,
Lire l'article
Vers un plan national « copropriétés »
Le phénomène des copropriétés en difficulté prend de l’ampleur. L’Anah propose trois mesures phares pour mieux informer les acquéreurs : l’obligation d’affichage des charges courantes et du coût prévisionnel des travaux dans les annonces immobilières ; la réalisation obligatoire, tous les dix ans, d’un diagnostic technique global destiné à mieux échelonner les travaux ; la création d’un fond de travaux
Lire l'article
Ce qu’il faut savoir concernant les achats sur plan
Acquérir un bien neuf reste synonyme d’achat sur plan, ou VEFA. La majorité des immeubles neufs est vendue sur plans. Pour l’acquéreur, acheter un bien qui n’existe que sur le papier n’est pas facile. Mais la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), l’autre nom de la vente sur plan, comporte aussi des avantages, notamment des frais de notaire réduits, des
Lire l'article
De l’optimisation fiscale à l’abus de droit
L’optimisation de patrimoine est l’objectif logique de tout père de famille désireux de faire fructifier ses biens de manière intelligente. Pour mener à bien cette stratégie, il peut être tentant d’utiliser certains silences de la réglementation, ou de combiner de manière avantageuse plusieurs régimes fiscaux. L’écueil de ces stratégies porte un nom : il s’appelle abus de droit. Il peut
Lire l'article
Fin de l’âge d’or de l’assurance vie
L’année écoulée a connu un fort recul de la collecte sur ses contrats d’assurance vie; ce résultat est principalement dû à !a crise financière qui a marqué 2011 et qui a créé un environnement peu propice à l’épargne longue. Cette crise financière est d’ailleurs entretenue par la crise de la dette souveraine, qui contraint l’Etat français à rechercher rapidement de
Lire l'article
Comment négocier son assurance emprunteur ?
Faut-il souscrire le contrat emprunteur collectif proposé par votre banque ou bien opter pour un contrat individuel ? La question est d’importance, puisque le coût de l’assurance représente de 5 % à 15 % du coût du crédit et peut varier du simple au double selon le contrat choisi. Liberté de choix Une démarche que favorise la loi Lagarde, entrée
Lire l'article
Les prix de l’immobilier vont baisser en 2012 et en 2013, selon les notaires
La baisse des prix observée depuis la fin 2011 devrait se poursuivre au moins jusqu’en 2013, selon les Notaires de France. Malgré ce retournement, les prix de l’ancien ont encore augmenté l’an dernier, mais pas de façon homogène. La hausse des prix de l’immobilier ancien est bel et bien enrayée, selon les notaires de France. Les prix avaient déjà commencé
Lire l'article
Permis de plus construire – Nouvelles réformes
L’urbanisme fait peau neuve avec 2 mesures phares qui touchent directement les particuliers en 2012. Le décret permettant d’augmenter de 20 à 40 mètres carrés le seuil de recours au permis de construire a été publié au journal officiel du 7 décembre 2011. En clair, si vous habitez en zone urbaine, vous pouvez désormais augmenter jusqu’à 40 m2 d’extension à
Lire l'article
Les prix de l’immobilier ont baissé au premier trimestre
Les prix ont bien baissé au premier trimestre 2012, mais pas de façon uniforme. Les chiffres région par région. La semaine dernière, les notaires avaient donné un aperçu de la baisse des prix en cours dans l’immobilier ancien. Sur base des promesses de vente déjà enregistrées, ces derniers anticipaient une baisse des prix d’environ 3 % sur six mois à
Lire l'article